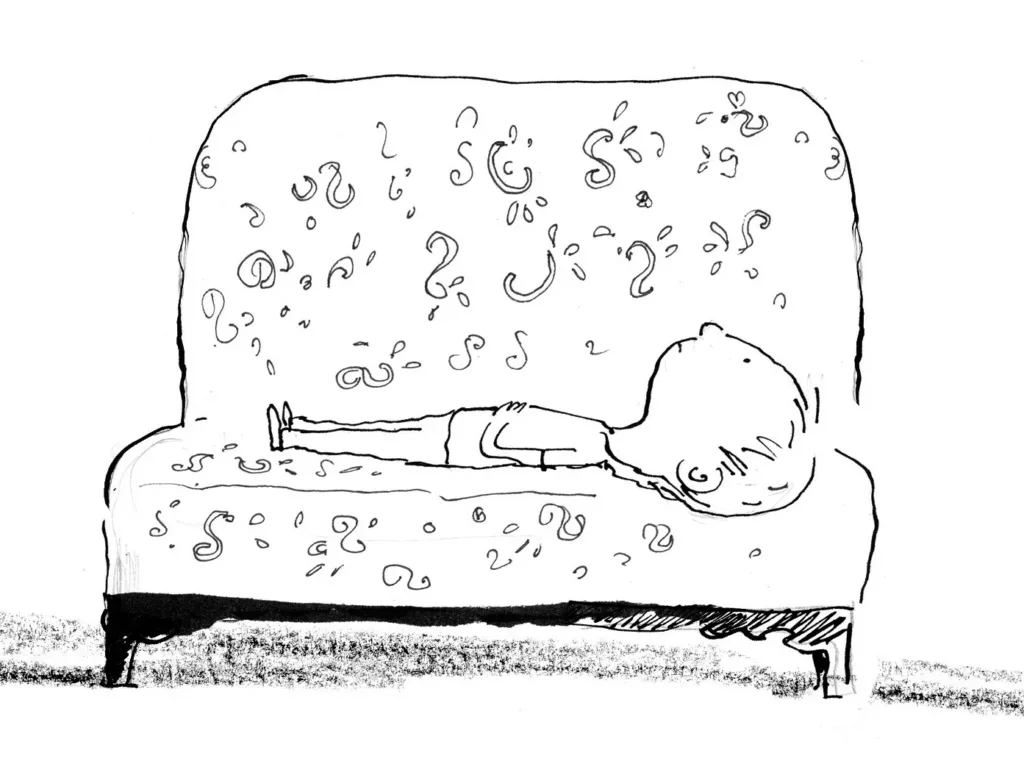Sa voix possède une tonalité de fillette espiègle, comme si à plus de 90 ans, Cynthia Ozick n’avait rien perdu de son enthousiasme ou son éternelle effervescence. Elle, qui est née – en 1928 – de parents immigrés pharmaciens, se souvient parfaitement de son enfance dans le Bronx américain. Ses études de lettres se sont clôturées par une thèse, consacrée à son « père spirituel », Henry James. L’auteure lui rend d’ailleurs à nouveau hommage dans son nouveau roman aux accents bibliques. Le stylo est « son gouvernail », qui tenaille ses émotions et ses interrogations existentielles. Poésie, théâtre, fictions ou essais (« Le châle », « A qui appartient Anne Frank ? », « Les papiers de Puttermeser », « Un monde vascillant », « Corps étrangers ») lui permettent d’explorer de nombreux sujets, comme le pouvoir de l’imaginaire, l’identité, l’Histoire ou la Shoah. Un air de mystère enveloppe ses livres, comme s’ils nous entraînaient toujours vers « une anomalie. Hors du cours ordinaire des choses. Une déviation. » Un chemin qui fait l’admiration de ses pairs et qu’on retrouve une fois de plus dans les « Antiquités ». Ce texte, aux multiples tiroirs, nous replonge dans la mémoire d’un homme vieillissant, Lloyd Wilkinson Petrie. Il semble avoir tout enfoui en lui, y compris la mort de son épouse, dont il fleurit fidèlement la tombe. Cet homme aux origines aristocratiques incarne un modèle de réussite, mais voilà que ses failles refont surface. Elles se trouvent dans son passé, or qui en possède véritablement les clés ? Retracer l’histoire de son ancienne école fait surgir un être bien particulier, Ben-Sion Elephantin. Rien que son nom laisse présager une destinée atypique. Celle d’un orphelin descendant d’une lignée judéo-égyptienne oubliée, comme peuvent l’être des strates entières de civilisations, retrouvées grâce aux travaux pertinents d’archéologues. Fouillant la foule de ses souvenirs, le protagoniste se heurte à ses désirs interdits et sa fascination pour une culture millénaire méconnue. Est-ce la rencontre avec ce garçon qui a orienté un pan de son existence, à priori parfaitement huilée ? L’Autre incarne souvent un double caché, jouant le rôle d’un révélateur inattendu. C’est avec délice que Cynthia Ozick nous dévoile les siens.
Qu’est-ce qui façonne notre identité et pourquoi est-elle constituée par notre histoire familiale, voire ancestrale ?
Voilà une question impossible, même si elle se trouve clairement au cœur de mon travail. Tout part de notre ADN… Mes parents sont issus du même shtetl, en Biélorussie. Mon père est arrivé en premier aux États-Unis. Il bénéficiait d’une éducation talmudique et parlait plusieurs langues : l’hébreu, le yiddish et le russe. Ma mère s’est retrouvée en Amérique, lorsqu’elle était enfant. Dans ce pays, ils ont compris qu’ils pouvaient être libres. Chacun y a le droit de devenir qui il veut. Ce lieu de tous les possibles leur a permis de respirer et de changer leur identité profonde. Celle-ci nous est connue depuis la naissance, surtout si on est juif.
Vous vous décrivez d’ailleurs comme « une auteure juive » et non pas comme un écrivain américain, pourquoi ?
J’ai toujours été passionnée par les livres, mais j’ai compris que je pouvais écrire mes propres histoires grâce à mon oncle, Abraham Regelson. Ce poète hébraïque et écrivain yiddish savait que l’écriture est faite de réalité. C’est lui qui m’a transmis cette vocation. Enfant, j’ai suivi des cours bibliques auprès d’un rabbin sceptique, estimant qu’une fille ne devait point étudier la Thorah. Mais ma grand-mère lui a tenu tête (rires). Ainsi, je suis devenue ouvertement un écrivain juif. Alors que dans la période d’après-guerre il était de rigueur de revendiquer son identité américaine, j’assumais pleinement mon héritage minoritaire. J’avoue en avoir payé le prix, puisque je suis nettement moins célèbre que Bernard Malamud, Saul Bellow ou Philippe Roth qui se percevaient comme des auteurs américains. Or je ne pouvais tout simplement pas faire autrement.
Ce roman nous familiarise avec l’égyptologue Sir Flinders Petrie qui se doit « d’excaver, au milieu d’un désert, ce qui repose sous la surface et ne souhaite pas être mis à jour. » Est-ce une métaphore de l’écrivain ?
Complètement, je dirais même que c’est sa parfaite définition. L’écrivain est un archéologue, du moins c’est comme ça que je le conçois. Certaines grandes figures littéraires, que j’admire, ne partagent pas cet avis. Susan Sontag soutient qu’on doit seulement écrire pour écrire. Elle a influencé l’ensemble de ma génération, également nourrie par les théories du « nouveau roman » à la française. Moi, je préfère mêler l’école du réalisme à celle de l’interprétation ou de l’imaginaire.
Originaire d’un milieu modeste, comment avez-vous trouvé votre voie littéraire ?
Cette interrogation me ramène en enfance, dans un quartier surpeuplé du Bronx. Totalement négligé, il ne possédait pas la moindre bibliothèque ou librairie. Or voilà que tous les vendredis, on avait droit à une « bibliothèque ambulante ». Ce camion vert arrivait toujours après l’école, alors nous l’attendions avec une telle impatience. Sur le sol boueux, étaient posées des boîtes de livres pour enfants. C’était magique ! La littérature me semble miraculeuse car elle nous entraîne là où nous n’avons jamais été, y compris dans la vie des gens. L’écriture demeure d’ailleurs pleine de surprises et d’énigmes, qui mettent tout sens dessus dessous.
Autre révélation Henry James qui nous encourage à « être libre, afin de s’inventer soi-même ».
J’ai lu tous ses livres et je rends d’ailleurs hommage à son esprit, dans ce roman-ci. C’est à 15 ans que je l’ai lu pour la première fois, grâce à mon frère qui est revenu à la maison avec une anthologie de science fiction. Une histoire de James m’a particulièrement marquée, « La Bête dans la jungle ». Elle nous présente un homme, attendant que quelque chose de remarquable lui arrive. Mais à la fin de son existence, il comprend qu’il n’en sera rien et que c’est précisément cela qui s’avère remarquable. Je me suis dit que c’était l’histoire de ma vie, mais je me suis visiblement trompée (rires). N’empêche que ma passion pour Henry James est restée. Il ne se contente pas de raconter une histoire, mais de l’interpréter sinon elle n’a pas de sens. Cela continue à m’inspirer, puisque je préfère regarder les choses en profondeur, au lieu de rester accrochée à la surface. Un roman sans conflits n’est pas un roman.
Lequel explorez-vous à travers ce narrateur tourmenté par son passé ?
La réalité paraît si improbable, qu’il nous faut de l’imaginaire y compris pour revisiter nos vies. C’est le cas de mon narrateur réécrivant sa propre histoire. Elle nous entraîne vers la rencontre de deux garçons, dans un établissement scolaire. L’arrivée d’un étrange personnage va bouleverser le premier à jamais car à travers ses yeux, il découvre l’antisémitisme, le monothéisme et un mystérieux héritage juif. Cette confrontation entre un aristocrate au sang bleu et son colocataire orphelin – issu d’une tribu oubliée – va aussi donner lieu à la naissance du désir et de l’amour. Cela m’amuse lorsque l’écrivain adopte le rôle du Diable dans le conflit. Il faut creuser en écrivant, entrer dans la tête et l’âme des êtres. La vérité exige une part d’imaginaire. Montaigne estime d’ailleurs qu’il a « tout un monde en lui ». Quelle sagesse. J’espère l’avoir aussi, même si je n’ai guère de réponses à mes questions. Peu de romans osent néanmoins aller dans les profondeurs de la condition ou l’âme humaine.
Est-ce parce que l’écriture vous met en danger ?
Quelle idée intéressante… Dès que je débute l’écriture d’un nouveau live, j’ai peur. On doit toutefois se forcer à aller jusqu’au bout, surtout s’il s’agit d’une fiction. Dans le cas d’un essai sur Henry James, c’est moins risqué car je connais le sujet. Mais lorsque je me lance dans un roman, cela me semble bien plus terrifiant, parce qu’on ne sait rien. Il faut tout trouver en soi et autour de soi. On saute véritablement en parachute, sans savoir s’il va s’ouvrir. Parfois, c’est exquis de trouver la langue et les mots adéquats.
Pourquoi est-ce que tous vos livres nous entraînent vers les marges ?
Parce que je ne sais pas faire autrement. Se mettre ainsi en danger peut paraître mélodramatique, alors même que je reste assise sur une chaise en me servant uniquement d’un stylo, une machine à écrire ou un ordinateur. Le pire, c’est quand on perd son texte pour des raisons technologiques. N’étant pas très douée dans ce domaine, je parviens heureusement à être sauvée par la nouvelle génération (rires). Pour revenir aux marges sociales, je dirais que ce thème m’intéresse tout particulièrement. C’est probablement dû à ma judéité. Que voulez-vous, les histoires de gens « normaux », qui parviennent à résoudre leurs problèmes dans un happy ending, ne m’inspirent pas. Je suis consciente que les premiers relèvent des best-sellers, mais ma vocation consiste plutôt à suivre l’exception et l’aliénation.
Votre héros « pense sans cesse à la mort, à l’oubli, au fait que rien ne dure » si ce n’est la littérature ?
Hélas non. Tant de gens n’ont pas accès à la littérature ou ne lisent tout simplement pas. La norme du moment étant plutôt de se tourner vers les écrans : l’ordinateur, l’iPad, la télévision ou le téléphone. Inversement, la mémoire est accessible à tous. C’est elle qui va durer pour l’éternité. Voyez mon protagoniste, ce vieil homme ayant connu un mauvais mariage. Il trouve quelque chose de nouveau, d’inhabituel et d’inspirant en songeant à un garçon de son passé. Lui, ce jeune homme de bonne famille aristocratique centenaire, trouve soudain une forme de salut et d’amour auprès de ce garçon, qui l’attire vers les marges. En dépit du rejet, il va connaître une expérience extra-ordinaire. Ce qui est écrit représente la clé de toutes les histoires, même celles qui n’ont jamais été écrites. Parce que l’écrivain peut donner vie à tout. Je ne le considère pas comme un Dieu, mais comme une forme de sagesse qui sort de l’ordinaire. En écrivant, j’ai compris ma peur et ma lâcheté, alors même qu’il faut tant de courage pour prendre sa plume et surmonter ces épreuves. J’ai mis longtemps à être publiée, mais c’est véritablement grâce à l’écriture que j’ai survécu pendant presque un siècle !
Un entretien réalisé par Kerenn Elkaïm.
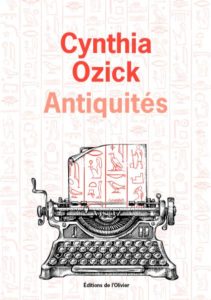
Cynthia Ozick, Antiquités, novembre 2022 (Édition de l’Olivier)
traduit de l’anglais par Agnès Desarthe
À retrouver chez mon libraire.