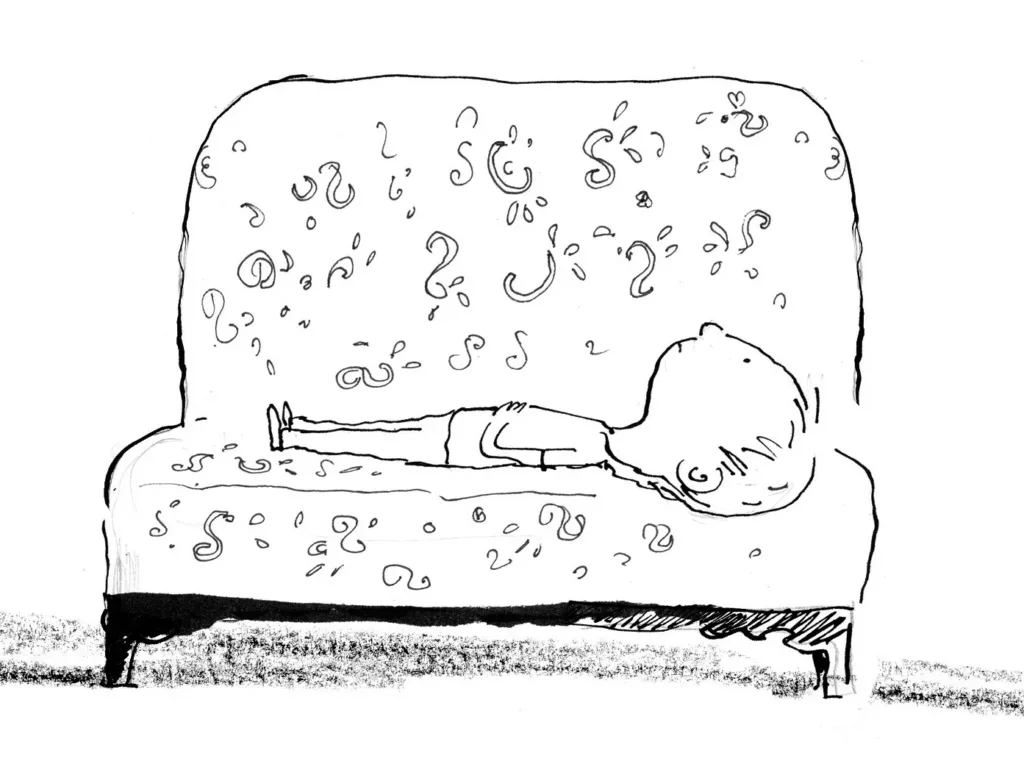De par son élégance naturelle, Elif Shafak pourrait passer pour une belle plante, mais ce serait ignorer son talent d’écrivain et sa passion des arbres. Méfiez-vous de sa douceur, ses romans et ses engagements ne sont qu’ardeurs. La défense des oppressés ou des oubliés lui valent des ennuis avec la Turquie, pays qui revient toujours dans ses romans (ex. « La bâtarde d’Istanbul »), mais où il lui est interdit d’aller. Or l’amour et l’imaginaire ne connaissent pas de freins littéraires… Ils nous entraînent cette fois à la rencontre d’Ada. Pourquoi pousse-t-elle un tel cri après la mort de sa mère ? Un cri brisant le silence originel de sa famille. Passé et présent s’alternent pour retracer la tragédie de la guerre civile chypriote. C’est là, qu’un étrange narrateur nous ouvre le cœur des Roméo & Juliette locaux. Une somptueuse histoire de mémoire et d’espoir, malgré les déchirements et le goût du pouvoir.
Vous écrivez qu’il y a « un certain nombre de choses qu’une frontière ne peut pas empêcher de traverser ». En quoi la littérature vous aide-t-elle à traverser des parties du monde et de vous-mêmes ?
Quelle magnifique question. Je m’intéresse depuis toujours à ce qui transcende les frontières. On a tendance à nous placer au sein de tribus, de pays ou de nationalités, or la littérature va bien au-delà de tout cela. Elle nous relie les uns aux autres, en nous rappelant qu’on n’est pas si différent. Ainsi, la littérature possède une résistence et une rébellion intérieure.
Pourquoi « n’y a-t-il presque pas d’histoires racontées par les perdants » ?
La plupart d’entre elles sont des « His-tories », à savoir des récits racontés au masculin. Je viens de Turquie, un pays qui cultive l’amnésie malgré une longue Histoire. Des trous que les ultra-nationalistes ou les islamistes s’efforcent de combler. Cette mémoire imposée n’a qu’un un seul narrateur. Je fais l’inverse en donnant une voix aux minorités oubliées ou oppressées. Proche de la périphérie, je me suis toujours sentie différente, comme si j’étais à la fois une outsider et une insider. Elevée par deux femmes dichotomiques (ndlr. sa mère diplomate et sa grand-mère très traditionnelle), je ne m’intégrais pas à l’école turque, qui m’imposait une seule vision du monde. Je suis devenue une émigrante écrivant dans une autre langue que la sienne (l’anglais). Mais de par ce sentiment d’exil, je suis une autre, voire tous les Autres.
Ce roman donne justement la parole aux « migrants, aux exilés ou aux déracinés ». Qu’est-ce qui vous révolte dans la façon dont ils sont traités ?
Que signifie être enraciné ou déraciné ? On m’accuse d’être « une cosmopolite sans racines », or pourquoi les associe-t-on au sol ou à la Nation, et non au ciel ? Loin d’être statique ou unique, l’identité peut avoir plusieurs racines et appartenances. On peut aimer sa terre ancestrale et natale, tout en se sentant lié à une autre région mondiale. Contrairement aux nationalistes, je suis une citoyenne du monde. En cette ère d’anxiété, on semble indifférent au sort des migrants qui meurent ou souffrent chaque jour. A force de les réduire à des chiffres impersonnels, on oublie que ce sont des êtres humains comme vous et moi. La destruction climatique fera d’ailleurs un jour, de chacun de nous, des réfugiés. En fermant les portes de nos frontières, on croit que les problèmes s’évanouiront. Quel leurre ! Voyez les inégalités de la vaccination du Covid, qui ne sera vaincu qu’en s’unissant.

Vous écrivez qu’il « y a des moments dans la vie, où on doit tous devenir des guerriers. » Les mots constituent-ils l’arme idéale ?
Si on est un raconteur d’histoires, il y a des moments de l’Histoire, où il est inévitable d’aborder le monde ou la politique. Surtout si l’on vient de démocraties blessées, comme la Turquie. Dès qu’on touche aux inégalités sexuelles, à la violence liée au genre, à l’homophobie, au sexisme, au racisme ou aux minorités, on parle de politique. Impossible de faire taire la féministe en moi, alors je suis un écrivain engagé. Les livres dévoilent notre jardin intérieur… Même des lecteurs conservateurs peuvent oublier leurs préjugés en lisant l’histoire de Turcs, de Chypriotes, d’Arméniens, de juifs ou d’homosexuels. En faisant le lien avec d’autres êtres, ils redeviennent humains.
Ce livre se déroule à Chypre dans les années ’70, alors qu’il existait « une ligne verte séparant les Grecs des Turcs et les chrétiens des musulmans. » Pourquoi cette histoire est-elle méconnue ?
Elle l’est partout, même par les pays colonisateurs. Chypre a connu l’invasion ottomane ou anglaise, qui a suscité des violences ethniques. On doit saisir cela, afin d’aider les habitants à travailler ensemble sur leur passé. Beaucoup de jeunes ou de femmes désirent bâtir la paix. Pour écrire ce roman, j’ai rencontré le comité bénévole qui tente de déterrer les disparus, lors de la guerre civile des années ’70. Le but : leur offrir une sépulture, afin que les desendants puissent enfin entamer leur deuil. On retrouve ce phénomène en Espagne, en Amérique du Sud, en Bosnie, en Pologne ou en Irak. La mémoire est essentielle car ce qui ne peut pas être réparé, finira par se répéter. Je m’intéresse à l’Histoire passée sous silence, y compris dans les familles. Même si j’ai grandi en Turquie, le drame chypriote était très présent en nous. Quand les humains se déchirent, ils finissent pas détruire les animaux et les arbres.
« Nous les arbres, nous ne pouvons qu’observer, attendre et témoigner. » Etant un écrivain turque, de quoi vous sentez-vous le témoin ?
Votre question me touche car nous nous trouvons au carrefour de l’humanité. Il n’y aura pas de « retour à la normale » : l’ancien monde est en train de disparaître et le nouveau n’est pas encore né. Ces temps incertains étant effrayants, on voit apparaître des démagogues proposant des solutions faciles. Alors qu’en ces temps de Covid, on a besoin de solidarité, on assiste à une montée des nationalismes. Le déclin des droits féminins pointe que rien n’est acté, alors que les femmes et les minorités seront au premier rang des changements sociaux. C’est pourquoi, j’aspire à la sororité. J’aime les arbres au point de les enlacer, il me paraît donc urgent de se reconnecter à la nature. L’éco-féminisme incarne bien ces valeurs car on tend à détruire l’écologie et les femmes. Actuellement, 80% des gens migrent à cause de la crise climatique. Les femmes et les enfants en subissent la plus grande violence.
Comment avez-vous eu l’idée de faire parler un figuier et en quoi reflète-t-il votre « arbre intérieur » ?
Ce figuier se veut essentiel et spirituel. Tant la Bible que de nombreuses légendes mondiales prennent un arbre comme élément central (cf. le pommier du jardin d’Eden). Les arbres nous ont précédés et nous survivront, alors ils sont les témoins privilégies de notre présence, nos joies et nos drames. Mon arbre intérieur s’avère fondamental. À moi de le nourrir constamment. Les femmes l’entretiennent souvent mal, parce qu’elles sont dures avec elles-mêmes, or nous devons faire preuve de compassion envers nous-mêmes.

Qu’en est-il de la tristesse intergénérationnelle, incarnée par la jeune Ada ?
Je crois au pouvoir des émotions et des histoires, mais ce qui m’intrigue le plus, ce sont les silences familiaux dont on hérite. Nos douleurs, nos traumas et nos regrets ont un impact majeur sur les générations suivantes. Ce roman explore cette mémoire intergénérationnelle pour nous aider à voir le monde autrement. Il construit des ponts entre les êtres d’hier et d’aujourd’hui. Ada incarne une mixité d’héritages, mais elle ne peut pas les saisir toute seule. Tant de jeunes ont l’impression que les générations précédentes ont détruit le monde. Ils tanguent face à l’incertitude du passé et de l’avenir.
Arrachée à votre terre turque, avez-vous l’impression d’être une éternelle exilée ou est-ce possible de replanter ses racines ailleurs ?
Difficile d’y répondre, tant le mot exil est lourdement connoté, mais il est vrai qu’il m’a façonnée. Je ne peux plus retourner en Turquie car mes positions engagées m’enverraient directement en prison. Malgré la mélancolie, je crois qu’on porte les lieux en soi. Et puis, quelle richesse de se connecter à d’autres cultures. Il y a toutefois un être fracturé en moi, puisque quelque chose me ramène toujours à mes origines ou à l’enfance. Bien qu’on puisse planter ses racines ailleurs, on demeure un arbre blessé, un « arbre migrant ». Je le soigne en plantant les graines de la vie dans mes livres.
Ici, vous semez aussi des amours impossibles. Pourquoi payent-elles un prix aussi élevé En temps de guerre ou de déchirements ethniques, les amours interdites payent le prix fort, mais l’amitié et l’Eros sont plus puissants que la haine. Dans cette Chypre de 1974, on n’a pas le droit d’aimer quelqu’un qui ne soit pas de son sang, de son rang ou de sa religion. Or « Roméo & Juliette » reste un mythe universel. La haine m’inquiète, parce qu’on n’apprend jamais rien de l’Histoire. On la croit linéaire et progressiste, or impossible de garantir que demain soit plus égalitaire. Au contraire, on peut reculer et refaire les mêmes erreurs. En cette ère de crise pandémique, socio-politique et écologique, on devrait cultiver plus d’empathie.
Vous écrivez que « les ponts apparaissent dans nos vies seulement quand nous sommes prêts à la franchir », pourquoi ?
Parce qu’on n’est pas toujours prêt pour aller à la rencontre d’un lieu, d’une histoire ou d’une personne. Il suffit d’un moment, voire d’une coïncidence. L’amour nous transforme, mais il ne suffit pas. C’est aussi valable pour l’écriture… Cela faisait longtemps que je voulais écrire ce roman sur Chypre, or les livres ne viennent à moi que lorsque je suis prête à les accueillir. Cette leçon soufique se veut une quête sans fin…
La mère d’Ada était « courageuse, un réel esprit libre. » Et vous ?
Je ne sais pas (rires). Disons que j’aime la liberté, l’égalité et la diversité, mais c’est indéniablement dans l’écriture que je me sens la plus libre. Ma terre natale est désormais la terre des histoires. C’est à elle que j’appartiens pleinement.
Un entretien réalisé par Kerenn Elkaïm.
Des portraits réalisés par Jean-Luc Bertini
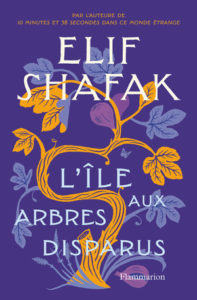
Elif Shafak, L’île aux arbres disparus (Flammarion).
Traduit de l’anglais par Dominique Goy-Blanquette.
À retrouver chez mon libraire.