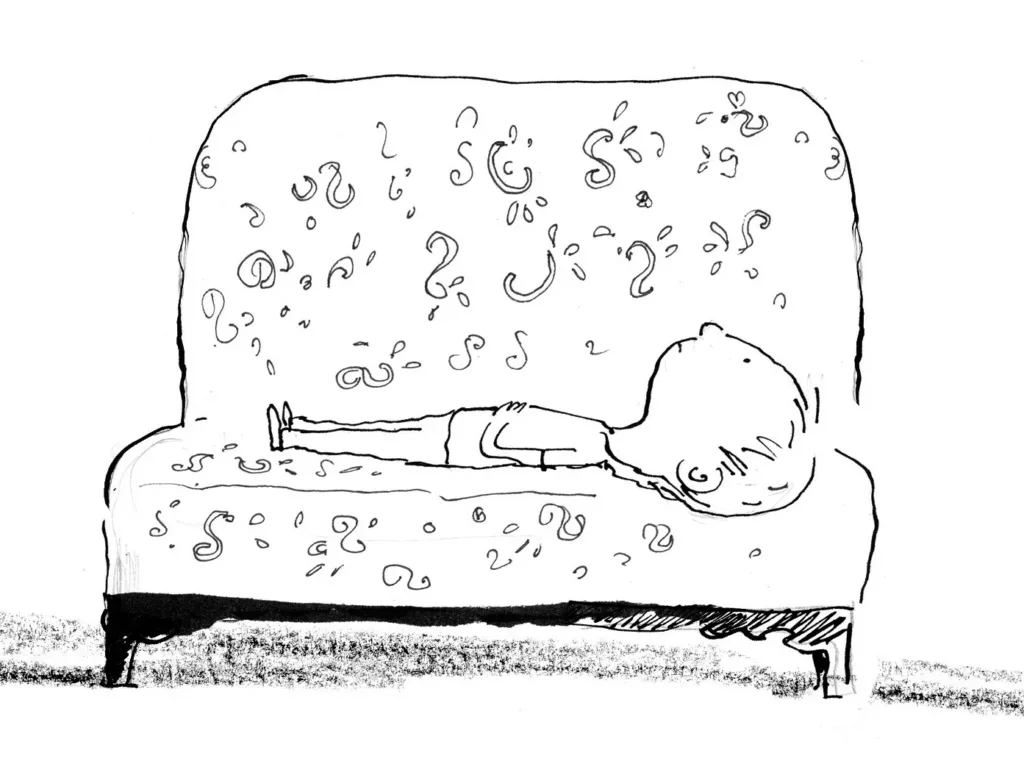Le roman aborde de nombreux sujets, vouliez-vous au départ parler du vieillissement et de la trahison du corps ?
Oui, entre autres choses. Quand le corps décline à cause du sport, on ressent une étrange indignation. On est censé être récompensé pour ses efforts et ses sacrifices, pas puni. Donc ce déclin semble moralement pervers et injuste même si au fond, ce n’est pas le vrai problème.
Pourquoi traiter ce sujet à l’intérieur d’un couple qui se livre une guerre larvée ?
Ce n’est pas autobiographique. Mon mari et moi ne communiquons pas au sujet de notre programme de fitness parce qu’il n’en a aucun ! C’est mon problème. Il fait partie de ces hommes qui restent en forme sans rien faire. Mais comment font-ils ?! En réalité c’est un article du New York Times sur les ultra triathlons qui a déclenché l’idée du livre. L’ultra triathlon n’est pas juste un triathlon, il faut recommencer chaque jour. Quelqu’un l’a même fait pendant 30 jours, ce que j’ai trouvé inconcevable. Mais l’aspect le plus intéressant de l’article résidait dans les nombreux commentaires qui exprimaient des opinions très tranchées, contradictoires. Certains lecteurs trouvaient cela merveilleux et admirable. D’autres, plus nombreux, pensaient que c’était un gaspillage d’énergie et de temps. Beaucoup disaient : mais pourquoi ces gens ne vont-ils pas plutôt faire du bénévolat à la soupe populaire, distribuer de l’eau dans les villages africains ? Ce qui est absurde mais cela m’a beaucoup frappée. J’ai transféré ce débat dans le livre.
Dans le roman les membres du groupe de triathlon compensent des faiblesses par le sport : ils ou elles sont malmenés au travail, dans leurs familles…
Ils ont besoin d’avoir un but, comme nous tous. Je ne veux pas les mépriser. Ils cherchent un sens de la communauté. Ces événements de masse sont une façon de rencontrer des gens, il y a un sens de la solidarité. Un tel projet, une fois qu’on s’y est engagé, commande une grande partie de la vie. Il faut se lever à 4H du matin pour s’entraîner, avoir des règles… C’est très prenant, mais cela donne un but, un programme. Et je crois que c’est un soulagement pour beaucoup de gens.

Serenata est accusée d’appropriation culturelle parce qu’elle imite les accents et Remington est accusé de racisme et de sexisme puis licencié…Pourquoi avez-vous inséré cette problématique dans le roman ?
Mis à part quelques références, le livre n’est pas clairement situé dans le temps. La politique identitaire a commencé à grandir depuis 2015-2016, pendant les années Trump. Je ne mentionne jamais son nom, intentionnellement, mais l’histoire se passe à cette période. Il fallait aussi que Remington ait une motivation forte pour se mettre au sport d’endurance. Il devait être désoeuvré. Je voulais aussi que sa motivation soit négative : il se punit. Il doit renoncer à sa vie professionnelle alors n’était pas du tout prêt à prendre sa retraite. Soixante ans, c’est bien trop tôt. Il est licencié et accusé du pire qui puisse arriver à un homme. C’est à la fois injuste et déshonorant.
L’élection de Trump a conduit à examiner pourquoi il avait été élu et ce qui se passait avec les hommes blancs en Amérique. Et l’un des thèmes secondaires du livre est la condition de l’ homme blanc en Amérique aujourd’hui. C’est bien moins drôle qu’avant ! On peut dire que c’est juste, parce qu’ils ont dominé le pays, mais je n’en suis pas convaincue et je n’aime pas l’idée que personne ne veuille plus être en empathie avec une catégorie entière de la population. Tout le monde mérite l’empathie, même les hommes blancs. Et je crois qu’il existe une empathie spéciale qu’on réserve à ceux dont ont dit qu’ils n’en méritent aucune. J’ai vécu cela au moment de la parution de Il faut qu’on parle de Kevin.
Dans cette histoire de tuerie de masse dans une école, je me suis intéressée au point de vue des parents des meurtriers, ceux que personne ne voulait écouter. On disait qu’ils auraient dû voir que quelque chose n’allait pas avec leurs fils ou qu’ils avaient créé un monstre. Donc je suis allée voir la mère du meurtrier parce que je trouvais que c’était extrêmement douloureux, je voulais regarder des gens pour qui personne n’avait de compassion. C’est la même impulsion dans ce roman.
Vous écrivez la scène de l’audience où Remington doit se justifier devant ses collègues comme un tribunal stalinien ou un pièce de théâtre de l’absurde. Qu’est-ce que cela dit sur le langage ?
C’est presque comme du Ionesco. Je crois que tout cela relève de l’absurde. L’extrême gauche est devenue tellement pointilleuse. J’ai bien peur que cet incident, que j’ai créé, soit du domaine du possible. Si on tape sur le mauvais bureau, cela pourrait être interprété comme une agression, un acte violent, du racisme et du sexisme. Je n’aime pas le langage laid, le double langage, je n’aime pas le jargon, je n’aime pas qu’on me dise quels mots je dois utiliser. Et la politique identitaire essaie de s’imposer par le langage. Cela vient des postmodernistes qui ont mis beaucoup d’emphase dans le langage et utilisé le pouvoir du langage pour contrôler et modeler la réalité. C’est un gros problème pour les écrivains. Il y a tout un arsenal de terminologies que je refuse d’utiliser dans mes romans ou mes articles.
Est-ce possible aujourd’hui aux Etats-Unis d’écrire sur la politique identitaire et de s’en moquer ?
Cela me met dans une position difficile par rapport à certaines personnes. Et les articles qui me sont consacrés sont très politiques. Les auteurs lisent mes livres avec une idée préconçue, une hostilité préalable. Sans surprise, ces articles ne sont pas justes, ils attendent un faux pas politique et n’entrent pas dans l’histoire. C’est dommage. J’ai perdu des lecteurs notamment à cause de mes articles dans la presse (pour le journal anglais The Spectator). Des gens très à gauche ont tendance à ne pas lire mes livres. Je pourrais ne pas lire les livres des gens de gauche mais dans ce cas je ne lirais plus aucun roman contemporain ! Je voudrais clarifier : je ne me considère pas comme complètement de droite, mais quand on n’est pas loyal à la gauche, il n’y a pas d’alternative, la position modérée n’est pas possible. Le débat politique aux Etats-Unis est très polarisé, et c’est à peu près la même chose en Angleterre.

Le roman parle aussi de la façon dont un couple vit ensemble en ayant plus de temps. Cela peut être difficile mais cela peut aussi être une bonne chose …
À la fin du livre c’est une bonne chose. Les personnages sont devenus plus sages et c’est un sentiment agréable pour le lecteur. Serenata arrête de lutter contre le vieillissement, parce que de toute façon c’est impossible, et Remington cesse d’être amer. Le triathlon est derrière lui, il ne va plus s’entraîner et ils trouvent un terrain d’entente. J’aime le fait qu’ils redeviennent un couple.
Faites-vous partie de la première génération qui refuse de vieillir ?
Ma génération de boomers est la première à avoir été obsédée par le sport. Ce n’était pas le cas de mes parents. Nous avons commencé, le phénomène a continué et s’est accéléré. Nous serons aussi la première génération à accepter le fait que courir 16 km par jour ne nous protège ni de la maladie ni de la mort. Nous avons fait du mal à nos corps et nous devons l’accepter comme une sorte de sagesse. Je n’en suis pas vraiment là, je ne fais plus mes « burpees » parce que je ne peux plus. C’est dur d’accepter ses limites, mais on n’a pas le choix.
Un entretien réalisé par Sophie Joubert.
Des portraits réalisés par Jean-Luc Bertini.

Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes, Lionel Shriver (Belfond).
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Catherine Gibert.