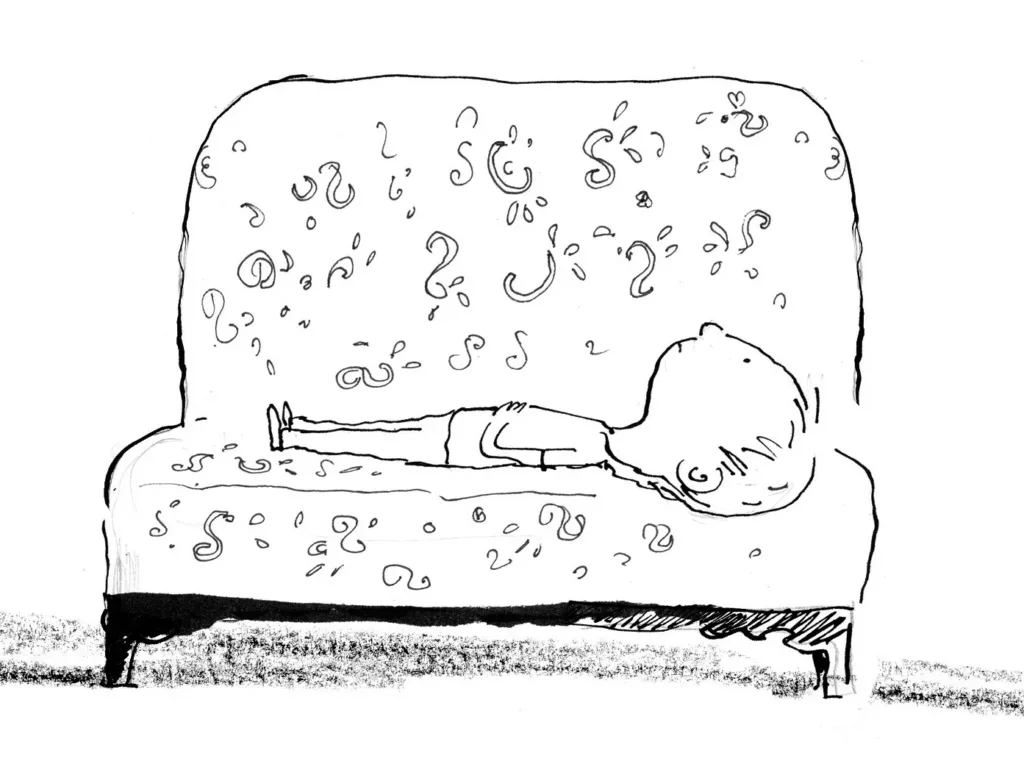À plus de 80 printemps, il paraît normal de faire le bilan de son existence. Regarder en arrière n’est pas une mince affaire, surtout si on a passé sa vie à mentir. L’heure de se repentir est arrivée pour Leonard Fife, un célèbre réalisateur de documentaires. Lui, qui a passé tant d’années à fuir, se retrouve brusquement au pied du mur. La maladie lui murmure sans répit que son corps se dégrade et que sa fin est proche, alors il se livre à un ultime entretien qui ressemble à un confessionnal, en face caméra. Dans ce huis-clos, parfois oppressant, les mots coulent à flots pour avouer l’inavouable et se regarder enfin en face. Outre le portrait d’un homme, l’auteur reflète l’histoire éhontée d’une certaine Amérique. Elle non plus ne souhaite guère affronter son passé. A force d’ériger les êtres en mythes, notre société oublie que nous sommes juste des humains fragilisés. Curieux de tout, Russell Banks nous offre, sans tabous, un personnage au bout de son parcours. Difficile de ne pas songer à ses propres questionnements sur l’âge et les mirages de la vie. Il avoue ressentir une certaine urgence face au temps qui avance. Son envie d’écrire et de poursuivre cette quête effrénée, d’une vérité nue, le pousse tous les jours à prendre la plume. Impossible d’oublier d’où il vient et ce qu’il a vécu pour en arriver là. Sa sincérité amicale et son rire désarmant en font un moment unique.
Comment êtes-vous « tombé amoureux de la lecture » tardivement ?
Au début, je m’imaginais plutôt devenir peintre car j’adorais dessiner depuis l’enfance. Cela allait de pair avec un talent d’observateur. Mais malgré les encouragements, mon chemin a bifurqué vers la littérature. A 18 ans, je m’étais installé à Miami, où je vivais de petits boulots, notamment celui de décorateur de vitrines. L’ennui et la solitude m’ont poussé vers la bibliothèque locale. Quel choc ! C’est là que j’ai découvert que la lecture était la chose la plus merveilleuse qui soit. J’ai longuement ignoré cette révélation clé car personne, à la maison ou à l’école, ne m’avait guidé vers cette voie. Ayant mis la barre très haut, j’ai d’abord voulu imiter la poésie de Walt Whitman, mais c’était trop dur (rires). Puis, je me suis amusé à singer la prose si riche de Faulkner ou Hemingway. Ce sont ces maîtres qui m’ont appris à écrire. Toute ma vie énergétique, sociale et économique a tourné autour de cet art, synonyme de multiples de nuits blanches.
Vous m’avez confié un jour que « plus vous avancez en âge, plus vous réalisez que votre travail reflète votre enfance ». Pourquoi ?
C’est vrai et pas vrai. Disons qu’il est d’avantage le reflet de ses effets secondaires. La violence de mon père alcoolique, la dépression de ma mère et ma solitude d’enfant unique ont forcément influencé ma vie et mon rapport aux femmes. Difficile de raconter cela… A travers ce roman, j’essaye de montrer qu’on se raconte tous l’histoire de nos vies. Il ne s’agit ni de fiction ni de vérité. J’avoue que plus je vieillis, plus je suis persuadé qu’on invente notre passé. Lorsque ma mère a écrit ses mémoires, j’ai compris que les souvenirs étaient mystérieux. Ainsi, j’ai été ému de voir qu’elle n’évoquait jamais sa propre mère. Au-delà de mon étonnement, j’ai senti que ce « grand blanc » cachait une immense douleur.
En quoi l’écriture est-elle salvatrice, à vos yeux ?
Mon enfance violente m’avait transformé en un jeune homme turbulent, colérique, voire autodestructeur. Dire que j’aurais pu mal finir… Or voilà que l’écriture m’a obligé à réorganiser et à structurer l’ensemble de ma vie. La rigueur qu’elle implique m’a engagé dans un monde sérieux, discipliné et honnête car l’écrivain se doit de raconter la vérité.
Laquelle ?
Il y en a tant qui s’emmêlent. Rien qu’en rembobinant le fil de sa vie, mon narrateur en perçoit l’ampleur. Outre sa vérité à lui, on perçoit celle de sa femme Emma – témoin de son existence – de son infirmière haïtienne ou du réalisateur, derrière la caméra. Chaque vérité s’avère subjective, illusoire, mensongère ou tronquée. D’autant que les souvenirs de Leonard Fife sont floutés par la chimiothérapie, le désespoir et les multiples éléments impossible à vérifier. Autre vérité abordée, celle de l’Amérique puisque mon héros est un déserteur de la guerre du Vietnam, mais on découvre petit à petit, qu’il fuyait bien autre chose.
Comment avez-vous traversé cette période de la guerre du Vietnam ?
Je me revois, comme hier, très engagé dans les mouvements anti-guerre. Toutes les familles étaient concernées. Mon frère et mes voisins étaient partis là-bas. J’ai déjà souvent abordé ce thème dans mes livres, mais là, je voulais revenir sur un aspect oublié. Celui de ces 60.000 hommes, fuyant au Canada afin d’échapper à leur enrôlement et d’obtenir un statut de réfugié. En dépit de la forte pression du FBI et du président Nixon, ils n’ont pas été extradés. La plupart d’entre eux se sont assimilés et ne sont jamais revenus. Seuls 10% de ces déserteurs sont rentrés au pays, où ils ont été traités de traîtres. Les Américains ont tendance à créer des figures héroïques toutes les cinq secondes – y compris parmi les victimes – mais j’estime qu’il n’y a que des anti-héros. Les êtres humains sont capables du meilleur comme du pire. Voyez mon protagoniste qui se livre à une confession étonnante, où il affronte ses mensonges et ses vérités.
Est-ce que « seul l’espoir mène au pardon » ?
Je suis sûr que le pardon et la rédemption demeurent possibles, même après des années de mensonge, comme en témoigne mon héros. Or seul le lecteur peut décider s’il lui accorde son pardon ou non, mais j’espère surtout qu’il ne le juge pas. Après tout, Fife n’a tué personne, il a « juste » créé une fausse identité, trahi et abandonné tous les siens.
Ce roman s’ouvre sur une phrase du poète portugais Pessoa : « Lorsque je me souviens qui j’étais, je vois un autre. » Si vous vous regardez dans le miroir, qui voyez-vous ?
J’aperçois effectivement toujours un autre que celui que je suis aujourd’hui. Cette citation me plaît beaucoup, parce que cet écrivain possédait également plein d’identités. N’est-il impossible de se cantonner à une petite boîte ? Le passé semble désormais figé, alors j’apprécie ce moment de mon existence où l’on ne vit plus vraiment dans le passé ou l’avenir, tant nos agissements semblent limités. J’ai eu la grande chance d’écrire ce roman, intitulé « Forgone » aux États-Unis, alors qu’en français, mon fidèle traducteur Pierre Furlan a opté pour mon titre original. Il a été terminé, il y a trois ans, mais j’en ai encore écrit d’autres depuis. Ma plume évolue à toute vitesse car mon temps est compté. Exigeant envers moi-même, je m’oblige à écrire une page par jour, tous les matins. C’est pourquoi l’écriture demeure « mon royaume magique ».
Est-ce que ce livre peut-être perçu comme une forme de testament, que vous nous léguez ?
Merci pour cette question. J’aime l’image d’un « héritage », qui revient d’ailleurs souvent dans mon travail. Même enfant, on dit qu’il faut préserver ses souvenirs. Quel héritage laisse-t-on finalement derrière soi ? Voilà l’une des questions que pose ce roman. Il appartient à chacun de trouver sa réponse. Dans mon cas, ce sont évidemment plein d’écrits. Une interview ne peut pas contenir l’ensemble d’une existence, n’empêche que ça reste troublant. Je me souviens m’être prêté au jeu avec une équipe de la télé hollandaise. A l’instar de ce roman, elle avait plongé la pièce dans le noir. C’est alors que je me suis retrouvé seul, face à une caméra. Me plonger dans l’obscurité m’a renvoyé à l’isolement total de l’écrivain.
Alors que la vieillesse paraît encore taboue, comment la percevez-vous ?
Impossible d’échapper à cette réalité qui nous attend tous. Aux États-Unis, la maladie et la mort demeurent taboues. D’ailleurs la religion renforce cette pensée. Même si l’Occident le nie, l’âge représente l’aspect universel de l’être humain. Et oui, personne n’en sort vivant ! Ma mère a vécu jusqu’à 96 ans. Sarcastique, elle me disait : « Russell, si tu as de la chance, tu verras tous tes amis mourir. » Elle n’a pas eu tord. Étant toujours en vie, j’espère bénéficier de son humour et de ses gènes. Jamais je n’aurais pu imaginer ce roman il y a vingt ans. Il explore la confrontation avec la fin de vie. Cela comprend d’affronter sa propre extinction avec courage.
« Le corps est une bataille », comme l’expérimente Fife. A travers lui, aimeriez-vous nous renvoyer à notre fragilité et à celle des hommes ?
La vérité de la fiction se doit d’inclure ce thème. Le Covid nous l’a d’ailleurs rappelé, surtout aux États-Unis où nous n’étions guère équipés. Cela a entraîné un million de morts. Un chiffre terrible en si peu de temps, or on fait semblant que cette réalité n’existe pas. Ainsi, nous avons seulement répondu aux besoins économiques, pas aux besoins humains. Au-delà du manque de masques, protecteurs pour les autres et soi, on a prouvé qu’on se croit encore immortels. Le rôle de l’artiste est de se battre contre ce déni, histoire de nous ouvrir les yeux.
En quoi est-ce que cela le met en danger ?
Tant de dirigeants et de dictatures tendent à cacher ceux qui racontent la vérité. Exilés, réfugiés, emprisonnés ou assassinés, les écrivains sont de plus en plus en danger. D’autant que la résurgence des pulsions fascistes apparaît dans le monde entier. Même les États-Unis ont connu un degré extrême avec la présidence de Donald Trump. La bataille pour la vérité reste donc plus que jamais d’actualité !
Autre thème éternel, l’amour. Pourquoi reste-t-il essentiel pour votre narrateur « jusqu’à sa mort » ?
Leonard Fife est incapable d’aimer, parce qu’il fait partie de ces êtres qui s’en protègent tant cela les rend vulnérables. Ce n’est qu’à la fin de son existence qu’il prend le risque de l’amour avec Emma. J’avoue que je n’ai pas eu ce problème. Cela fait trente-cinq ans que je suis heureux dans mon mariage, qui a donné lieu à 4 filles et plusieurs petits-enfants. On comprend souvent à quel point l’amour s’avère réconfortant avec l’âge. Chaque vie peut être un miracle. Surtout la mienne, qui m’a permis de donner et de recevoir autant d’amour. Telle est ma véritable joie.
Un entretien réalisé par Kerenn Elkaïm.

Russell Banks, Oh Canada, septembre 2022 (Actes Sud)
traduit par Pierre Furlan.
À retrouver chez mon libraire.