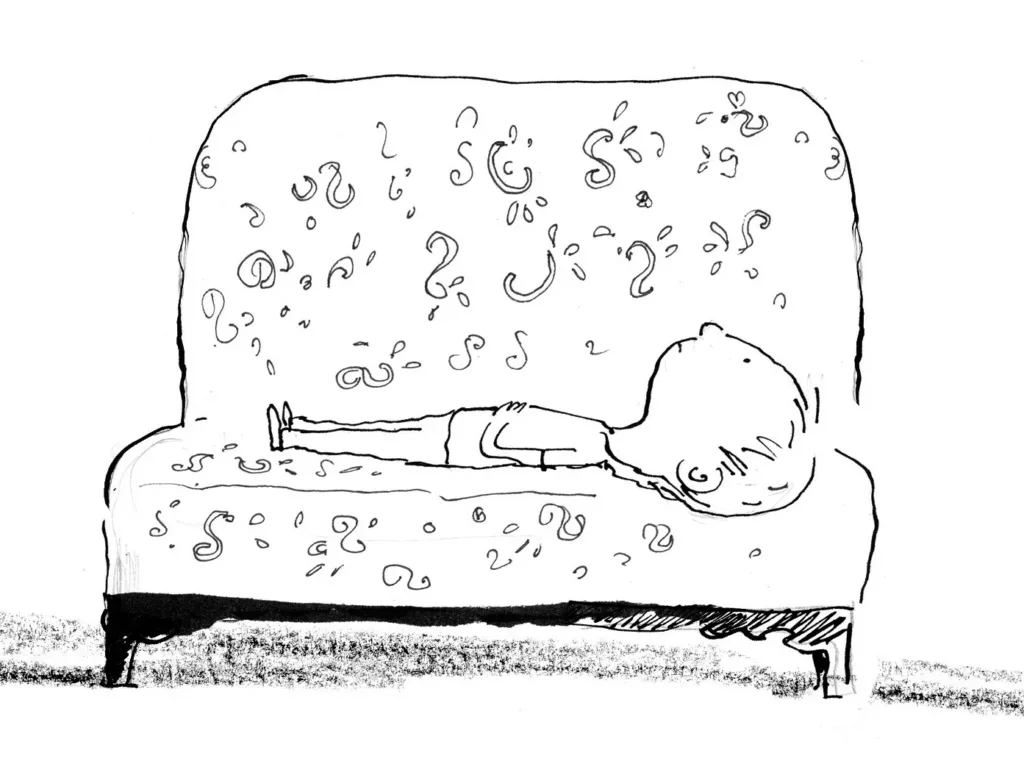Très accueillant et généreux, Santiago Gamboa s’exprime parfaitement dans la langue de Molière. Un héritage de son existence à Paris, où il a adoré évoluer. Nous le retrouvons d’ailleurs dans un pt’it hôtel près de la Place Saint-Sulpice. L’écrivain colombien se sent ici en terrain connu. Lui, qui idolâtre George Perec, estime que « chaque partie d’une maison raconte une histoire formant la fresque d’une vie ». Celle qui est au cœur de son nouveau roman existe vraiment. Composée de briques rouges à l’anglaise, elle incarne un retour au bercail, après trois décennies d’errance, de journalisme et de diplomatie. Une envie de se poser que partage son personnage principal. Ce professeur énigmatique, hanté par une enfance fracassée, a besoin de s’y réfugier avec sa tante protectrice. Mais il est parfois assailli par la violence du trauma et d’une Colombie, où règne la dichotomie. Tout comme lui, Gamboa est un collectionneur insatiable de livres. « Je refuse de les ranger par ordre alphabétique », tant le chaos des mots le nourrit à l’infini. « Ma bibliothèque est mon vrai chez-moi »
Si « c’est agréable de se laisser piéger par une bibliothèque », comme vous l’écrivez, à partir de quand est-elle devenue votre refuge ?
Depuis toujours, puisque je suis né dans une maison emplie de 5000 livres. Je les regardais longuement, quand je ne savais pas encore lire, car je pressentais qu’ils renfermaient quelque chose d’important. Comme si j’avais déjà compris qu’une bibliothèque reflétait l’identité de quelqu’un. Ainsi, j’adhère totalement à la théorie de Rodrigo Fresan, « la vraie patrie d’un écrivain est sa bibliothèque. » La mienne contient tous mes changements de vie, de pays ou d’influences (Vargas Llosa, Graham Green, Sartre).
Vous avez dit un jour que « la littérature est une force qui peut sauver les gens désespérés. » De quoi vous a-t-elle sauvé ?
La lecture et l’écriture constituent la totalité de mon existence. Face aux soucis ou aux difficultés, elles m’apportent un apaisement, un équilibre, voire même des solutions. J’ai décidé, déjà enfant, que je vivrai ma vie à l’intérieur de la littérature, parce que j’avais le pressentiment que c’était un monde en soi. Cela m’inquiète d’ailleurs que l’on s’oriente désormais vers un système consumériste rendant la lecture plus difficile. Parfois, j’ai l’impression que nous sommes la dernière génération de lecteurs, or tant de jeunes auteurs me prouvent le contraire. Les livres lus sont des livres vécus. A mes yeux, la littérature est une invitation à vivre. Impossible de séparer les deux. Il faut donc vivre pour mieux écrire.

La tante du narrateur est persuadée que « tous les écrivains sont des êtres fragiles ». Et vous ?
C’est valable pour les artistes en général car nous recherchons quelque chose qui nous manque dans la vie. Bien que ça demeure inatteignable, on peut l’approcher par l’art. Cette carence nous pousse à la création et rétablit un certain équilibre. C’est dans cet espace, que je peux dire des choses inexprimables ailleurs. Plein d’écrivains sont venus à la littérature pour échapper à des pulsions ou des envies suicidaires. Aussi est-elle comparable à « un hôpital psychiatrique » (rires). Cette fragilité représente une blessure invisible, soignée par la création qui n’existe pas dans la réalité. Loin d’accepter la tragédie, je remélange les cartes du poker de l’existence.
Votre protagoniste soutient « qu’en termes littéraires, une famille est une longue narration épique. Certaines sont des romans d’amour, d’autres des romans d’aventure. » Pourquoi ce roman-ci se centre-t-il sur une famille brisée ?
L’idée familiale est bien résumée par Tolstoï : « Toutes les familles heureuses se ressemblent et se distinguent dans la tristesse. » Le vrai défi étant de trouver sa place au sein de ce long roman et de savoir ce qu’on va y ajouter. Ici, je décris une famille brisée et recomposée. Grâce à leurs souvenirs et leurs vécus respectifs, mon narrateur et sa tante vont pouvoir reconstruire ensemble un nouveau chapitre à leur roman familial. Celui-ci a certes été fracassé par une tragédie, mais leurs liens vont s’en trouver consolidés. Après tout, on ne peut pas être malheureux toute sa vie. La Maison est au cœur même de cette histoire. Celle de la jeunesse de mon héros a été témoin de son enfance et de son drame. Or celle de son âge adulte correspond à un renouveau. Elle existe réellement, puisque c’est là que je vis aujourd’hui.
Qu’incarne dès lors celle de Chapinero ?
Pour un enfant, sa maison représente l’univers entier. Certaines demeures sont témoin de grands bonheurs, d’autres de tristesses ou de tragédies comparables à l’enfer. Dignes d’un thermomètre, elles prennent le pouls de ce qui se déroule entre les murs. Il suffit juste d’y exister… Le destin de l’être humain est de la quitter. Mais dès qu’on va vers une ville inconnue, on n’est plus aimé. Il s’agit d’un passage entre un lieu de protection et un espace anonyme. Grâce à la lecture, j’ai eu une enfance heureuse, d’autant que je savais que cela se prolongerait à l’âge adulte. Une bourse pour Madrid m’a permis de quitter la maison à 19 ans. Que ce soit là ou à Paris, je m’en suis pris plein la gueule. Il faut parfois se faire cogner par la vie pour grandir…

Ayant connu l’exil, que signifie pour vous avoir une maison ?
Cette notion change avec le temps et les différents pays où j’ai vécu. Lorsque je suis rentré en Colombie, je me sentais exilé car j’étais parti depuis si longtemps. Ce mot n’est d’ailleurs pas adapté à ma situation, parce que je pouvais revenir quand je le souhaitais. A force de déménager aussi souvent, j’ai appris à porter ma maison sur le dos.
Ce roman se veut-il aussi un portrait de la Colombie et de Bogota, cette ville où « les quartiers pauvres sont un enfer comparable aux tableaux de Jerôme Bosch. » Et où deux mondes co-existent sans jamais se croiser.
Mon livre se déroule à la fin du XXè siècle. Il y a eu des changements positifs depuis, mais cette réalité demeure. Je dirais plutôt que c’est le portrait d’une cité très latino-américaine, avec ses problèmes, ses inégalités, sa violence et ses nombreuses injustices. C’est pourquoi les citoyens y font face à un monde très dur. J’ai vécu à Londres, où les riches et les pauvres se côtoient au quotidien, puisque les uns travaillent chez les autres. A Bogota, on refuse cependant de voir ceux qui vivent dans la précarité. Inspirant le dégoût, la pauvreté se doit d’exister de loin. Cela engende une société très violente, où les rapports entre les classes s’avèrent extrêmement tendus. Pas étonnant que la drogue y soit le seul moyen de « mobilité sociale ».

Tout comme vous, la tante du héros a travaillé à l’Unesco. Quel est votre sens de l’engagement ?
Dans l’univers littéraire anglo-saxon, un auteur ne se mêle pas de politique, mais je préfère cette idée française selon laquelle l’écrivain et l’intellectuel se doivent d’être à l’écoute du monde, afin de justifier leur place dans la société. Nous cultivons la même philosophie en Amérique latine. Impossible de ne pas se laisser imprégner par l’environnement socio-politique et la violence ambiante. La plupart des écrivains signent d’ailleurs des chroniques d’opinion dans les journaux. C’est également mon cas. Mon modèle a longuement été Mario Vargas Llosa qui incarnait le guerrier socio-démocrate, mais je ne partage plus ses idées atroces. Même si c’est stimulant d’être en désaccord, j’avoue qu’il m’a déçu. Travailler pour l’Unesco a été un honneur et je continue d’ailleurs à faire partie du jury d’un prix défendant la paix.
Votre narrateur affirme que « l’amour n’est pas son fort ». Pourquoi a-t-il besoin de s’en protéger ?
Il a besoin de se préserver d’une certaine idée de la vie, de la mémoire, de la tragédie. C’est pourquoi il se réfugie auprès de sa tante. Vivre avec quelqu’un d’autre signifierait entrer dans une histoire différente. Fidèle à l’amour presque filial de sa tante, il se contente de rencontres sexuelles. Psychologiquement, le concept de la Famille est trop lié au drame qu’il a vécu enfant. Aussi ne ressent-il pas d’élan pour aller la chercher. Ce traumatisme produit des rapports parfois cruels, parce que s’il tombe amoureux, les choses peuvent lui échapper. Alors il préfère disparaître, même s’il fait souffrir celles qu’il aime.
Est-il dès lors fidèle à sa liberté ?
La liberté est à double tranchant. Dans le roman « Soumission » de Houellebecq, la liberté peut nous écraser. Car si Dieu n’existe pas, tout est permis. C’est à chacun de soi de faire le choix du Bien ou du Mal. La théorie de Houellebecq étant que la soumission nous libère, puisqu’on n’a plus le pouvoir de choisir. Je perçois plutôt la liberté par rapport à l’écrivain que je suis. A savoir un espace de vie lié à la création artistique. Ça implique d’avoir du temps libre, du silence pour lire et écrire. Cela me force à parcourir les villes, afin de me promener dans d’autres temps et rêver tranquillement. Ainsi, j’aspire à vivre littérairement ma vie !
Un entretien réalisé par Kerenn Elkaïm.
Des portraits réalisés par Jean-Luc Bertini

Santiago Gamboa, Une maison à Bogota, mars 2022 (Métailié)
traduit de l’espagnol (Colombie) par François Gaudry
À retrouver chez mon libraire.